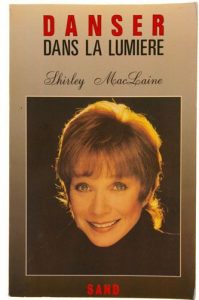par Andr√© Couture, Universit√© Laval,¬Ý8 septembre 2017
R√©sum√©¬Ý: Ce petit texte propose une d√©finition du mythe et l‚Äôillustre √Ý partir d‚Äôune interpr√©tation mythique de trois histoires connues¬Ý: le r√©cit hindou du soul√®vement du mont Govardhana par K·πõ·π£·πáa, les r√©cits chr√©tiens de la transfiguration de J√©sus et de la temp√™te apais√©e. Il se termine par l‚Äôinterpr√©tation d‚Äôun mythe contemporain, le r√©cit d‚Äôune vision obtenue par Shirley MacLaine.[1]
Contrairement √Ý l‚Äôimpression persistante et superficielle selon laquelle le mythe serait synonyme de fabulation trompeuse, de vaine illusion, de mystification gratuite, les sp√©cialistes de sciences des religions, et en particulier les anthropologues int√©ress√©s au fait religieux, consid√®rent qu‚Äôil v√©hicule sous forme de r√©cits un discours essentiel dont se nourrissent √Ý leurs fa√ßons toutes les religions, toutes les cultures. J‚Äôh√©site √Ý parler de discours symbolique, √©tant donn√© que le symbole est lui aussi un terme galvaud√© qu‚Äôon utilise trop souvent en certains milieux pour court-circuiter des r√©alit√©s culturelles jug√©es incompr√©hensibles √Ý l‚Äôaune de la soci√©t√© contemporaine. La notion de symbole sert alors √Ý √©liminer de fa√ßon √©l√©gante des textes que l‚Äôon ne comprend plus ou que l‚Äôon n‚Äôose plus transmettre tels quels. On peut dire par exemple du discours chr√©tien sur la r√©surrection qu‚Äôil rel√®ve du symbole, ce qui ne signifie nullement que la r√©surrection serait une simple expression de l‚Äôesp√©rance humaine interchangeable par exemple avec la croyance au sh√©ol ou la croyance en la r√©incarnation. Tout symbole s‚Äôinscrit √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôun syst√®me symbolique particulier qui demande √Ý √™tre d√©cod√© en tant que tel. Dire que les religions s‚Äô√©quivalent toutes correspond √Ý mon avis √Ý une forme de d√©mission intellectuelle. On caresse peut-√™tre un r√™ve de tradition primordiale pure, mais on se refuse √Ý comprendre la r√©alit√© d‚Äôaujourd‚Äôhui dans toute sa diversit√© et sa complexit√©. Respecter l‚Äôautre, c‚Äôest accepter son originalit√©, sa diff√©rence, ce qui fait qu‚Äôil ne sera jamais ce que je suis. C‚Äôest √Ý ce prix qu‚Äôun r√©el √©change peut s‚Äôinstaurer. Autrement, on se r√©fugie dans une pieuse fiction qui donne l‚Äôimpression de dialogue et de fraternit√© universelle, une pseudo-rencontre o√π les interlocuteurs s‚Äôannihilent eux-m√™mes en refusant de se confronter √Ý la diff√©rence de l‚Äôautre.
Le mythe propose une histoire, des histoires, mais ne rel√®ve pas de l‚Äôhistoire au sens o√π les historiens d‚Äôaujourd‚Äôhui en parlent. On ne cherche pas √Ý y exposer des faits sous tous les angles possibles et √Ý partir de tous les documents disponibles. On ne vise pas √Ý se distancier de ce qui a pu se passer pour obtenir la vue la plus englobante possible d‚Äôune r√©alit√© complexe. En fait, l‚Äôopposition entre mythe et fait historique n‚Äôappartient pas au bagage culturel des juifs traditionnels, des premiers chr√©tiens, ou des hindous de l‚ÄôInde. √Ä l‚Äôint√©rieur de ces traditions, ce qu‚Äôon appelle aujourd‚Äôhui ¬´¬Ýmythe¬Ý¬ª n‚Äôest tout simplement qu‚Äôune histoire comme toutes les autres, m√™me si quand on l‚Äôexamine attentivement, on peut ajouter que c‚Äôest une histoire √Ý laquelle on accorde encore davantage de cr√©dit. Elle met en sc√®ne certains √©l√©ments jug√©s primordiaux √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôune certaine culture, et cela en utilisant souvent des personnages exemplaires, plus grands que nature, en dramatisant en quelque sorte le message annonc√©. Ces dieux ou ces h√©ros existent bien aux yeux de ceux qui se transmettent ces histoires, quoiqu‚Äôil puisse aussi arriver que la tradition ne soit pas dupe et que l‚Äôon se raconte ces histoires avec un sourire entendu. D‚Äôautres personnes peuvent √©galement penser que ces personnages sont de pures projections de l‚Äôimagination, et c‚Äôest leur droit. En fait, l√Ý n‚Äôest pas la question si l‚Äôon pense que le mythe comprend d‚Äôabord une certaine mise en sc√®ne. Quoi qu‚Äôon pense du statut ontologique des entit√©s dont on parle dans ces mythes, on ne doit jamais en conclure que celles-ci n‚Äôont rien √Ý dire de pertinent √Ý la soci√©t√© dont ils sont issus. Pour une culture, une religion donn√©e, ces dieux, ces h√©ros parlent de r√©alit√©s, de valeurs consid√©r√©es comme vraies, essentielles, inali√©nables. Et ce sont pr√©cis√©ment ces r√©alit√©s, ces valeurs que l‚Äôon souhaite transmettre en racontant ind√©finiment les m√™mes histoires.
On a progress√© dans l‚Äôinterpr√©tation des mythes quand on a r√©alis√© que ceux-ci servaient √Ý communiquer un message et que le discours mythique ne pouvait par cons√©quent exister sans mettre en ≈ìuvre une s√©rie d‚Äôoppositions n√©cessaire √Ý l‚Äô√©tablissement d‚Äôun code sp√©cifique au groupe concern√©. C‚Äôest depuis, entre autres, les travaux de Claude L√©vi-Strauss (1908-2009) que l‚Äôon a appris √Ý ranger le mythe parmi les syst√®mes symboliques au m√™me titre que les langues, les rituels, les syst√®mes de parent√©. Pour communiquer un message religieux, la communaut√© concern√©e utilise donc le code qui lui est familier, que ses membres comprennent, et qui fait appel √Ý des personnages ou √Ý des notions connus. Il suffit souvent d‚Äôun mot pour √©voquer une r√©alit√© qui s‚Äôoppose √Ý d‚Äôautres r√©alit√©s et l‚Äôensemble des symboles √©voqu√©s dans de telles histoires s‚Äôinscrit alors dans une coh√©rence sp√©cifique. Une image isol√©e ne signifie rien. C‚Äôest l‚Äôensemble de ces images, dont aucune n‚Äôest gratuite, qui, en s‚Äôopposant les unes aux autres, devient un code susceptible de v√©hiculer un message √Ý cette communaut√©. Si, au terme de l‚Äôinterpr√©tation que l‚Äôon fait d‚Äôun r√©cit mythique, il reste encore la moiti√© des √©l√©ments demeur√©s inexpliqu√©s ou myst√©rieux, c‚Äôest peut-√™tre que l‚Äôon a pas r√©ussi √Ý d√©coder la langue utilis√©e, ou que l‚Äôon n‚Äôen conna√Æt pas suffisamment le contexte culturel pour donner aux images utilis√©es leur sens pr√©cis. On s‚Äôest longtemps d√©barrass√© des mythes orientaux en disant que leurs auteurs n‚Äôavaient en fait pas encore eu acc√®s √Ý la pens√©e v√©ritable et que, contrairement aux Occidentaux, ils ne r√©ussissaient qu‚Äô√Ý balbutier. ¬´¬ÝLes anciens philosophes ‚Äî ajoute L√©vi-Strauss ‚Äî raisonnaient sur le langage comme nous faisons toujours sur la mythologie. Ils constataient que dans chaque langue, certains groupes de sons correspondaient √Ý des sens d√©termin√©s, et ils cherchaient d√©sesp√©r√©ment √Ý comprendre quelle n√©cessit√© interne unissait ces sens et ces sons. L‚Äôentreprise √©tait vaine, puisque les m√™mes sons se retrouvent dans d‚Äôautres langues, mais li√©s √Ý des sens diff√©rents. Aussi la contradiction ne fut-elle r√©solue que le jour o√π on s‚Äôaper√ßut que la fonction significative de la langue n‚Äôest pas directement li√©e aux sons eux-m√™mes, mais √Ý la mani√®re dont les sons se trouvent combin√©s entre eux¬Ý¬ª[2]. L√©vi-Strauss en conclut que le sens d‚Äôun mythe ne peut √™tre dans ses √©l√©ments pris isol√©ment, mais dans la fa√ßon dont ces √©l√©ments se regroupent, s‚Äôarticulent les uns aux autres. Ce sens est alors plus complexe que celui que l‚Äôon transmet gr√¢ce √Ý la langue de tous les jours¬Ý: il se situe m√™me au-del√Ý de celui-ci. Tout cela veut dire qu‚Äôil est aussi vain de vouloir interpr√©ter un r√©cit mythique en utilisant un dictionnaire de symboles √©sot√©riques cens√© rendre compte une fois pour toutes des images utilis√©es par toutes les cultures et toutes les religions, que de chercher √Ý d√©coder une langue sp√©cifique (le chinois ou le finnois) en pr√©tendant avoir d√©couvert un sens unique et universel pour chaque phon√®me.
Le plus souvent, la communaut√© concern√©e se contente de raconter, et donc de transmettre, une histoire √Ý laquelle elle voue sa fid√©lit√©. Cette histoire peut prendre des formes qui varient selon les circonstances dans lesquelles elle est racont√©e. Les recherches modernes s‚Äôacharnent √Ý r√©p√©ter qu‚Äôil est vain de rechercher ¬´¬Ýla¬Ý¬ª version premi√®re, authentique, pure, non frelat√©e d‚Äôun mythe. Au contraire, toutes les versions du mythe sont valables, essentielles¬Ý: ¬´¬ÝIl n‚Äôest pas de version ‚Äúvraie‚Äù dont toutes les autres seraient des copies ou des √©chos d√©form√©s. Toutes les versions appartiennent au mythe¬Ý¬ª, disait encore L√©vi-Strauss[3]. Une des caract√©ristiques du mythe, je l‚Äôai d√©j√Ý dit, est d‚Äô√™tre r√©p√©t√©, r√©p√©t√© ind√©finiment. Le mythe est vivant au sens qu‚Äôil fait partie de la liturgie qui donne forme et vie √Ý la communaut√©. Bien qu‚Äôil puisse avoir √©t√© √©crit, dans les soci√©t√©s traditionnelles, ces histoires se transmettent oralement le soir pr√®s du feu et jusque tard dans la nuit. Ce peut √™tre √©galement √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôun rite r√©gulier qui fait partie de la routine d‚Äôune grande √©glise ou d‚Äôun groupe plus petit¬Ý; il peut √™tre aussi proclam√© et comment√© solennellement dans le faste d‚Äôune cath√©drale. Dans tous les cas, la r√©p√©tition du mythe sert √Ý construire l‚Äôidentit√© du groupe concern√©, et cette r√©p√©tition n‚Äôexclut pas les variantes, les adaptations, √©ventuellement les innovations.
Peut-on reconna√Ætre de tels r√©cits dans la Bible ou √Ý l‚Äôint√©rieur des interminables collections de textes hindous¬Ý? Il n‚Äôy a pas de truc infaillible, mais certains indices peuvent aider, comme le fait pour un r√©cit de se d√©rouler hors du monde, avant la cr√©ation du monde ou apr√®s sa destruction. Les premiers historiens des religions ont insist√© sur le fait que le mythe se d√©roule √Ý l‚Äôorigine, au temps jadis, dans un monde d√©sormais disparu, dans un ailleurs inaccessible. Il peut aussi arriver, √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôun m√™me texte, que le passage de la description banale de la r√©alit√© quotidienne √Ý la proclamation d‚Äôun grand discours √Ý forte teneur mythique soit marqu√© par un indice d‚Äôordre temporel ou g√©ographique. Le lieu o√π se passe alors cette histoire diff√®re de l‚Äôespace ordinaire o√π les vivants circulent librement. Le r√©cit de la transfiguration de J√©sus se d√©roule sur une montagne¬Ý; la temp√™te apais√©e sur un lac normalement calme¬Ý; l‚Äôenfance de K·πõ·π£·πáa dans une for√™t situ√©e √Ý l‚Äô√©cart de la ville de MathurƒÅ. Il s‚Äôagit de lieux de passage, habit√©s de brefs instants, en rupture totale avec la monotonie de la vie concr√®te. L‚Äô√©cart entre le temps ordinaire et ce temps o√π l‚Äôauditeur plonge quelques instants, entre la g√©ographie normale et ces lieux particuliers, peut s‚Äôinterpr√©ter comme autant de signes avertissant le lecteur ou l‚Äôauditeur qu‚Äôil doit changer de plan, se hausser √Ý un autre niveau. Il s‚Äôagit d‚Äôun temps ou d‚Äôun espace sp√©cial qui projette ce lecteur ou cet auditeur ailleurs, dans les zones les plus profondes de sa tradition, de sa culture, dans ce qu‚Äôil conserve de plus important une fois que la poussi√®re des ann√©es s‚Äôest dissip√©e. Des temps et des lieux qui forcent en quelque sorte la r√©flexion.
Si l‚Äôon voulait, avant de poursuivre, r√©sumer en une d√©finition ce qui vient d‚Äô√™tre dit, on pourrait dire du mythe, √Ý la suite de nombreux travaux d‚Äôorigines diverses, qu‚Äôil s‚Äôagit d‚Äôune construction narrative √Ý travers laquelle un groupe social sp√©cifique, par l‚Äôinterm√©diaire de ses sages (voyants, proph√®tes, griots, vieillards, etc.), s‚Äôexplique sa propre existence et lui donne du sens. Le r√©cit mythique, qui met souvent en sc√®ne des personnages plus grands que nature et vivant √Ý l‚Äô√©cart de la vie de tous les jours, propose, entre autres, une interpr√©tation des origines du groupe et un aper√ßu des valeurs qui d√©finissent son identit√©. Comme le mythe circule √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôun groupe social sp√©cifique, il se pr√©sente selon les circonstances sous des formes variables et il restera toujours impossible et sans int√©r√™t de vouloir en d√©couvrir une forme premi√®re qui serait la seule authentique.
Mais plut√¥t que d‚Äô√©piloguer √Ý vide sur le mythe, examinons de plus pr√®s quelques exemples, tir√©s dans un cas du c√©l√®bre Hariva·πÉ≈õa (IIe-IIIe si√®cles) qui relate, entre autres, l‚Äôenfance de K·πõ·π£·πáa, et dans l‚Äôautre cas des √©vangiles chr√©tiens (Ier si√®cle). Je suis indianiste, mais non hindou¬Ý; chr√©tien, mais non sp√©cialiste de l‚Äôhistoire des textes bibliques et de leur interpr√©tation. Je ne pr√©tends pas tenir ici de discours acad√©mique, j‚Äôessaie simplement de comprendre la mani√®re dont un lecteur cultiv√© et sensible pouvait recevoir de tels r√©cits, apparemment si √©tranges et fantastiques.
Le récit du soulèvement du mont Govardhana (HV 59-63, éd. cr.)[4]
L‚Äôhindouisme poss√®de ses histoires, qui paraissent encore plus √©tranges √Ý un Occidental qui les entend pour la premi√®re fois. L‚Äôeffort qu‚Äôil faudra faire pour les apprivoiser peut ensuite nous aider √Ý relire des textes chr√©tiens qui nous paraissent peut-√™tre plus familiers, mais qui n‚Äôen sont pas moins √©tranges eux aussi. Le contenu de ce r√©cit plonge ses racines dans un pass√© hindou mill√©naire. S‚Äôil a continu√© d‚Äô√™tre r√©p√©t√© jusqu‚Äô√Ý aujourd‚Äôhui, avec √©videmment toutes sortes de variantes, c‚Äôest sans doute qu‚Äôil contient une v√©rit√© inali√©nable, c‚Äôest peut-√™tre qu‚Äôil s‚Äôagit d‚Äôun v√©ritable mythe.
Menac√© par le m√©chant Ka·πÉsa, roi de MathurƒÅ, une ville situ√©e au sud de l‚Äôactuel Delhi, le tout jeune K·πõ·π£·πáa, en fait une incarnation du grand dieu Vi·π£·πáu, a √©t√© transport√© par son p√®re dans un campement de bouviers, o√π paissent les vaches de ce roi, des signes de sa richesse. Les bouviers ont d√ª d√©placer leur campement dans une seconde for√™t, celle du V·πõndƒÅvana. Les deux mois de mousson viennent de se terminer et font place √Ý la saison d‚Äôautomne. De retour au campement, les bouviers se pr√©parent √Ý c√©l√©brer Indra, le dieu de l‚Äôorage. √Ä un tr√®s vieux bouvier qui leur explique le sens de ces festivit√©s, K·πõ·π£·πáa r√©pond qu‚Äôen tant que bouviers, ce sont plut√¥t les vaches, les for√™ts et les montagnes qu‚Äôils doivent honorer. Rapidement convaincus, les bouviers pr√©parent de la nourriture et immolent des b√™tes en vue de ce nouveau sacrifice. Des brahmanes les aident. √Ä la fin du rite, gr√¢ce √Ý sa magie (mƒÅyƒÅ), K·πõ·π£·πáa se m√©tamorphose lui-m√™me en montagne et appara√Æt au sommet du mont Govardhana d‚Äôo√π il d√©vore les offrandes de nourriture. Pendant le rite de purification finale, il se d√©clare combl√© et sourit de sa forme divine. La montagne dissimule alors son corps divin et le jeune K·πõ·π£·πáa retourne au campement √Ý l‚Äô√©tonnement g√©n√©ral. Indra ne se tient pas pour vaincu et ordonne √Ý ses nuages d‚Äôorage de se d√©verser pendant une semaine sur ces bouviers r√©calcitrants et leurs vaches. La fin des mondes a l‚Äôair arriv√©e et la terre se mue en une onde unique (ekƒÅr·πáava). K·πõ·π£·πáa r√©fl√©chit alors √Ý un moyen de sauver les vaches de la col√®re du roi des dieux (61,26). Il s‚Äôapproche du mont Govardhana, l‚Äôarrache de sa base, et de sa main gauche le soul√®ve jusqu‚Äôaux nuages. Il ouvre ainsi un immense espace o√π vaches et bouviers viennent s‚Äôabriter. Indra comprend sa m√©prise et mus√®le ses nuages. Les vaches peuvent alors sortir du ventre de la montagne et retourner √Ý leur pacage. K·πõ·π£·πáa d√©pose son fardeau et redevient un simple petit bouvier. √âtonn√© d‚Äôun tel exploit, Indra rend visite √Ý son opposant et reconna√Æt aussit√¥t en lui Vi·π£·πáu en costume de bouvier (gopave·π£adhara·πÉ vi·π£·πáum, 62,4). Il le f√©licite d‚Äôavoir agi √Ý la mani√®re de BrahmƒÅ le cr√©ateur. Indra, jadis l‚Äôunique souverain des dieux, demande lui-m√™me √Ý K·πõ·π£·πáa d‚Äôaccepter l‚Äôonction royale et le titre de Govinda (¬´¬ÝTrouveur de vaches¬Ý¬ª) qui fera de lui le souverain universel. Au lieu de r√©gner pendant quatre mois, il ne conservera que les deux mois de mousson et c√©dera √Ý K·πõ·πá·π£a les deux mois de l‚Äôautomne. Un rite cosmique a lieu o√π Indra verse sur la t√™te de K·πõ·π£·πáa des cruches remplies d‚Äôun lait divin. Les vaches se joignent √Ý l‚Äôonction en couvrant K·πõ·π£·πáa de flots de lait¬Ý; les nuages pleuvent des averses d‚Äôambroisie¬Ý; les grands arbres secr√®tent une s√®ve lact√©e. Indra prie ensuite K·πõ·π£·πáa d‚Äôen finir avec le taureau Ari·π£·π≠a, le cheval Ke≈õin et le roi Ka·πÉsa¬Ý; il lui rappelle que lui-m√™me participera plus tard √Ý la guerre des BhƒÅrata en prenant l‚Äôaspect du guerrier Arjuna, et que son devoir sera de le prot√©ger pendant sa mission. Tandis qu‚ÄôIndra repart pour le ciel, K·πõ·π£·πáa re√ßoit les hommages des bouviers qui s‚Äôinterrogent sur son identit√©. Lui ne songe qu‚Äô√Ý s‚Äôamuser¬Ý: de jour il lutte en mani√®re de jeu avec des taureaux furieux¬Ý; de nuit il danse avec de jeunes bouvi√®res et chante l‚Äôamour.
Pour comprendre ce dont il est ici question, il faut d‚Äôabord prendre conscience que, dans ce contexte pr√©cis, le dieu supr√™me est pens√© comme un G√©ant primordial (ou un Homme cosmique) qu‚Äôon appelle le Puru·π£a supr√™me. En effet, un c√©l√®bre hymne du ·πögveda (10,90), datant peut-√™tre d‚Äôun mill√©naire avant l‚Äô√®re chr√©tienne, d√©crit la cr√©ation de l‚Äôunivers comme √©manant du corps de ce g√©ant. C‚Äôest en un semblable g√©ant au nom variable que les r√©cits ult√©rieurs verront le monde se r√©sorber √Ý la fin des √¢ges.
Un autre r√©cit me para√Æt essentiel, celui de la vision d‚Äôun grand asc√®te du nom de MƒÅrka·πá·∏çeya. Un jour, alors qu‚Äôil errait de lieu de p√®lerinage en lieu de p√®lerinage, en raison d‚Äôune faveur re√ßue du dieu supr√™me, ce sage traversa vivant le cataclysme d√©truisant toute vie dans l‚Äôunivers et s‚Äôengouffra dans la nuit cosmique. Soudain, envelopp√© par la magie du dieu supr√™me, il fut litt√©ralement aval√© √Ý l‚Äôint√©rieur de son corps et continua √Ý errer dans son ventre. Lorsqu‚Äôil en sortit, MƒÅrka·πá·∏çeya aper√ßut d‚Äôabord le dieu supr√™me comme une masse aussi √©norme qu‚Äôune montagne, et ensuite comme un enfant jouant ing√©nument, couch√© sur une feuille d‚Äôun immense figuier banian. Ce sage avait en quelque sorte per√ßu le paradoxe inh√©rent √Ý la conception de la divinit√© dans le vishnouisme hindou, un dieu qui peut appara√Ætre √Ý la fois comme un √™tre gigantesque et se manifester sous la forme d‚Äôun petit enfant.
Un dernier texte est ici essentiel¬Ý: la Bhagavad-Gƒ´tƒÅ [BhG]. Alors que le guerrier Arjuna, sur le point d‚Äôentrer dans la grande bataille, s‚Äôarr√™te, tent√© par le renoncement, K·πõ·π£·πáa, son cocher ou peut-√™tre son intelligence, le convainc qu‚Äôil faut non pas renoncer mais plut√¥t se consacrer √Ý son devoir d‚Äô√©tat. En l‚Äôoccurrence, Arjuna doit se battre puisqu‚Äôil est un guerrier, mais le faire en renon√ßant √Ý satisfaire ses caprices personnels. ¬´¬ÝMieux vaut s‚Äôacquitter ‚Äî m√™me m√©diocrement ‚Äî de son propre devoir d‚Äô√©tat (sva-dharma), plut√¥t que d‚Äôobligations √©trang√®res (para-dharma), f√ªt-ce √Ý la perfection. Il est pr√©f√©rable de mourir en ex√©cutant son devoir d‚Äô√©tat¬Ý; les obligations √©trang√®res sont porteuses de p√©ril¬Ý¬ª (3,35, trad. Esnoul/Lacombe). Et K·πõ·π£·πáa compl√®te sa pens√©e en disant¬Ý: ¬´¬ÝC‚Äôest par attachement √Ý l‚Äôacte (karman) que les ignorants agissent [...]¬Ý; le sage doit agir tout pareillement, mais sans attachement, ne visant que l‚Äôint√©grit√© de l‚Äôunivers¬Ý¬ª (3,25, ibid.). Le texte culmine en une vision o√π Arjuna se rend compte que K·πõ·π£·πáa n‚Äôest nul autre que le souverain supr√™me en qui tous les √™tres se r√©sorbent √Ý la fin d‚Äôune √®re cosmique.
Nous voil√Ý maintenant mieux outill√©s pour comprendre le r√©cit du Govardhana. Le nouveau sacrifice pr√©conis√© par K·πõ·π£·πáa se transforme rapidement en un rite merveilleux centr√© sur la montagne. Pour saisir le sens de ce r√©cit fantastique, il faut d‚Äôabord le replacer dans le contexte de la BhG. En acceptant de remplacer l‚Äôancien rite en l‚Äôhonneur d‚ÄôIndra par un rite nouveau valorisant le devoir d‚Äô√©tat de chaque caste, les bouviers se disent d√©j√Ý pr√™ts √Ý accepter l‚Äôenseignement que K·πõ·π£·πáa proclamera plus tard quand il sera devenu adulte. Ces bouviers vivent de leurs vaches, de leurs for√™ts et de leurs montagnes. Ce sont donc elles qu‚Äôils doivent honorer en premier lieu. Dans la BhG comme dans l‚Äô√©pisode du Govardhana, le v√©ritable d√©vot de Vi·π£·πáu-K·πõ·π£·πáa est celui qui accomplit la t√¢che qui lui a √©t√© assign√©e √Ý sa naissance, une t√¢che qui d√©finit √©galement le rituel auquel il devra s‚Äôastreindre sa vie durant.
Le discours du K·πõ·π£·πáa du Govardhana s‚Äôajuste parfaitement √Ý un contexte pastoral. Le r√©cit que l‚Äôon vient de lire pr√©sente essentiellement K·πõ·π£·πáa comme un enfant jouant dans la for√™t du V·πõndƒÅvana et qui se m√©tamorphose en montagne. Il illustre en fait le paradoxe qui sous-tend l‚Äôensemble du r√©cit d‚Äôenfance, et la fa√ßon complexe dont on se repr√©sente la divinit√© dans ce contexte. L‚Äô√©pisode du sage MƒÅrka·πá·∏çeya contemplant un dieu √Ý la fois montagne et b√©b√© rend tout √Ý fait plausible l‚Äôhistoire ainsi racont√©e et permet au lecteur de faire tenir ensemble des aspects qu‚Äôil pourrait √™tre port√© √Ý dissocier.
Le lecteur qui a lu la BhG sait √©galement que l‚Äôargumentation de K·πõ·π£·πáa d√©bouche sur le d√©voilement d‚Äôun grand secret. K·πõ·π£·πáa n‚Äôest nul autre que le grand g√©ant Vi·π£·πáu NƒÅrƒÅya·πáa, le dieu souverain qui √©met les √™tres, qui les d√©truit p√©riodiquement, et en qui ils se r√©fugient pendant la nuit cosmique. NƒÅrƒÅya·πáa est l‚ÄôHomme-Sacrifice ou le PrajƒÅpati (p√®re des cr√©atures) dont parlaient les anciens textes, celui qui absorbe tous les √™tres avant de les √©mettre √Ý nouveau. Il est la source de toutes les cr√©atures et la destination ultime de tous les sacrifices. Sans le savoir, tous les √™tres qui sacrifient honorent en fait ce grand dieu. Le nouveau rituel en l‚Äôhonneur du Govardhana s‚Äôadresse de toute √©vidence √Ý des auditeurs qui connaissent bien ces sp√©culations. Il s‚Äôagit d‚Äôune mise en sc√®ne que l‚Äôon peut dire eschatologique. Quand les bouviers entrent dans la montagne soutenue par un K·πõ·π£·πáa transform√© en pilier de montagne, c‚Äôest comme s‚Äôils entraient dans ce g√©ant cosmique qui les prot√®ge. Le dieu supr√™me, qui peut √™tre compar√© √Ý une montagne, est alors l‚Äô√™tre gigantesque vis√© par tous les sacrifices et la caverne dans laquelle tous les sacrifiants se r√©fugient pour √™tre prot√©g√©s.
Cet épisode, qui semble le produit d’une imagination débridée, s’avère en fait le fruit d’une construction précise qui apparaît peut-être un siècle ou deux après l’ère chrétienne mais prolonge et renouvèle une tradition lointaine et parfaitement maîtrisée. Le mythe du soulèvement du mont Govardhana est devenu si populaire en Inde, sans doute parce qu’il reflète de façon originale l’image complexe que les dévots se font de leur divinité. Comme la BhG et la vision du sage Mārkaṇḍeya, ce récit marque une rupture évidente avec la compréhension védique du dieu cosmique. Examinons maintenant deux récits chrétiens où Jésus se métamorphose d’abord lui aussi en un grand maître tout lumineux que l’on doit écouter, puis se mue en un nouveau Moïse pour soumettre avec puissance les eaux au nom de Dieu.
La transfiguration de Jésus (Marc 9,2-13)
Six jours apr√®s la confession de foi de Pierre √Ý C√©sar√©e de Philippe et l‚Äôenseignement sur un Fils de l‚Äôhomme qui doit souffrir avant d‚Äôentrer dans la gloire, J√©sus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les am√®ne √Ý l‚Äô√©cart sur une haute montagne. Il fut alors m√©tamorphos√© devant eux (c‚Äôest le mot grec utilis√©, c‚Äôest-√Ý-dire qu‚Äôil prit une forme diff√©rente), et ses v√™tements deviennent d‚Äôun blanc immacul√© et √©blouissant. √âlie et Mo√Øse apparaissent et se mettent √Ý causer avec J√©sus. Les disciples interloqu√©s proposent alors de construire trois tentes. Soudain une nu√©e appara√Æt et d‚Äôelle une voix se fait entendre¬Ý: ¬´¬ÝCelui-ci est mon fils bien-aim√©¬Ý: √©coutez-le¬Ý¬ª. Imm√©diatement, le rideau se baisse et J√©sus demeure seul avec ses disciples qui l‚Äôinterrogent sur le sens de la pr√©sence d‚Äô√âlie et d‚Äôun Fils de l‚Äôhomme qui doit souffrir avant de ressusciter. J√©sus se contente de recommander √Ý ses disciples le silence. Le texte de Marc est simple, moins explicite que ceux des deux autres √©vang√©listes (Matthieu 9,17,1-13¬Ý; Luc 9,28-36). Il suffira pour la pr√©sente d√©monstration.
La sc√®ne qui figure dans l‚Äô√©vangile de Marc se pr√©sente de l‚Äôext√©rieur comme un √©pisode parmi d‚Äôautres. Pourtant, le lecteur auquel s‚Äôadresse Marc conna√Æt tr√®s bien la Bible juive. En √©coutant cette histoire, il est imm√©diatement projet√© dans le pass√© que lui a r√©v√©l√© la Torah. Il voit se dresser devant lui une haute montagne, un certain Mo√Øse, un certain √âlie, des tentes, et tout cela dans un silence qui le force √Ý r√©fl√©chir.
Examinons les images qu‚Äôutilise ce texte et les clins d‚Äô≈ìil qu‚Äôil contient. J√©sus est au centre d‚Äôune sc√®ne destin√©e √Ý un cercle restreint de trois disciples¬Ý: Pierre, Jacques et Jean. C‚Äôest J√©sus qui conduit les disciples sur la montagne. C‚Äôest avec lui que causent √âlie et Mo√Øse. C‚Äôest √Ý lui que les disciples s‚Äôadressent avant qu‚Äôune voix, qui est celle du P√®re, ne se fasse entendre qui le concerne directement. C‚Äôest encore √Ý lui que les disciples demandent des explications.
Le J√©sus qui occupe le devant de cette sc√®ne est de toute √©vidence un Seigneur ressuscit√©, dot√© d‚Äôun corps r√©el mais tout en lumi√®re, un contexte que sugg√®re J√©sus en recommandant √Ý ses disciples de ne rien dire de ce dont ils ont √©t√© t√©moins ¬´¬Ýjusqu‚Äô√Ý ce que le Fils de l‚Äôhomme ressuscite d‚Äôentre les morts¬Ý¬ª (v. 9). Le r√©cit projette donc les lecteurs dans un futur qui est en fait le pr√©sent m√™me des lecteurs qui lisent un texte compos√© probablement au d√©but des ann√©es 70. Mo√Øse, en langage biblique, c‚Äôest le premier repr√©sentant de la Loi, la Torah. √âlie, c‚Äôest l‚Äôhomme de Dieu et le proph√®te par exellence, dont les juifs disent qu‚Äôil doit revenir lors de la venue du Messie. Mo√Øse et √âlie ensemble, c‚Äôest donc toute la Loi et les Proph√®tes, soit tout ce qui fait autorit√© pour les juifs. La haute montagne, c‚Äôest le lieu de la r√©v√©lation. L‚ÄôHoreb dans le Sina√Ø est la montagne o√π Yahveh a r√©v√©l√© √Ý Mo√Øse les tables de la Loi (Exode 24,12-18). C‚Äôest √©galement l√Ý qu‚Äô√âlie monta quand il voulut entendre Dieu lui parler (I Rois 19,8). Il est dit que J√©sus devint resplendissant, lumineux et qu‚Äôalors une nu√©e apparut. Les disciples demandent aussit√¥t qu‚Äôon installe des tentes (sk√®n√®). La tente, ou en terme plus savant le ¬´¬Ýtabernacle¬Ý¬ª, est d‚Äôabord consid√©r√©e dans la Bible juive comme l‚Äôabri servant √Ý prot√©ger l‚Äôarche d‚Äôalliance, le sanctuaire mobile qui accompagne les Isra√©lites au d√©sert. Cette tente sera remplac√©e plus tard par un temple fixe. On se souvient de la parole de J√©sus √Ý la Samaritaine¬Ý: ¬´¬ÝL‚Äôheure vient o√π ce n‚Äôest ni sur cette montagne (le mont Garizim) ni √Ý J√©rusalem (le mont Sion) que vous honorerez le P√®re‚Ķ¬Ý¬ª (Jean 4,21). Les disciples parlent donc d‚Äôenfermer ces trois pr√©sences d‚Äôautorit√© sous des tentes, mais le P√®re n‚Äôentre pas dans leur jeu. Il coupe imm√©diatement court √Ý toute sp√©culation¬Ý: sa voix s‚Äôimpose et dit de J√©sus¬Ý: ¬´¬ÝCelui-ci est mon fils bien-aim√©¬Ý: √©coutez-le¬Ý¬ª. En projetant son lecteur sur une montagne semblable √Ý celle o√π Mo√Øse avait jadis re√ßu les tables de pierre de la Loi antique, semblable √Ý celle o√π √âlie avait rencontr√© le Seigneur, et semblable √©galement √Ý celle o√π l‚Äôon avait toujours l‚Äôhabitude honorer Dieu, cet √©pisode oblige le lecteur √Ý conclure que celui que le P√®re d√©signe d√©sormais comme incarnant la Loi nouvelle, c‚Äôest le J√©sus glorifi√©, celui qui bient√¥t ressuscitera. C‚Äôest lui qu‚Äôil faut √©couter¬Ý: il si√®ge sur la montagne et √Ý lui seul il est la Loi et les Proph√®tes. Plus de temple de J√©rusalem, plus de tabernacle fix√© en un lieu sp√©cifique, contenant et limitant d‚Äôune certaine fa√ßon la pr√©sence de Dieu. C‚Äôest ce J√©sus ressuscit√© qui, par sa pr√©sence mobile partout sur terre, est au c≈ìur du nouveau message. Ce que ce r√©cit tr√®s simple met en sc√®ne, c‚Äôest donc la r√©v√©lation de la Loi nouvelle en J√©sus. Il s‚Äôagit d‚Äôun v√©ritable r√©cit mythique qui s‚Äôadresse au monde avec des personnages plus grands que nature, des personnages qui r√©utilisent par allusions subtiles des pans entiers de l‚Äôancienne r√©v√©lation pour leur faire signifier autre chose. Voil√Ý √Ý proprement parler un mythe essentiel √Ý la foi chr√©tienne, un grand discours qui plonge ses racines tr√®s loin dans le pass√© d‚ÄôIsra√´l et marque en m√™me temps une rupture compl√®te avec celui-ci.
La tempête apaisée (Marc 4,31-41)
L‚Äô√©pisode que l‚Äôon intitule unanimement ¬´¬Ýla temp√™te apais√©e¬Ý¬ª est un autre de ces r√©cits √©tranges qui donnent √Ý penser (voir aussi Matthieu 8,23-27¬Ý; Luc 8,22-25). J√©sus enseigne au bord de la mer de Galil√©e. La foule est telle que, pour bien se faire voir et entendre, J√©sus monte dans une barque et parle √Ý son auditoire de cette estrade improvis√©e. Apr√®s avoir prononc√© de nombreuses paraboles, le soir venu, il d√©cide de passer sur l‚Äôautre rive, suivi par d‚Äôautres barques. Survient un grand tourbillon de vent, avec des vagues qui remplissent l‚Äôembarcation. J√©sus, lui, dort comme si rien ne se passait. Les disciples le r√©veillent¬Ý: ¬´¬ÝMa√Ætre, cela ne te fait rien que nous p√©rissions¬Ý?¬Ý¬ª Alors, J√©sus se r√©veille, menace le vent et dit √Ý la mer¬Ý: ¬´¬ÝSilence¬Ý! Tais-toi¬Ý!¬Ý¬ª Et le vent tombe. J√©sus s‚Äôadresse alors √Ý ses disciples et leur reproche leur manque de foi. Eux se regardent en disant¬Ý: ¬´¬ÝQui donc est-il, pour que m√™me le vent et la mer lui ob√©issent¬Ý?¬Ý¬ª Ce r√©cit se d√©roule au milieu des eaux profondes et donc inverse en quelque sorte la pr√©c√©dente histoire qui se passait sur une haute montagne.
Des historiens se sont demand√© si, historiquement, cette sc√®ne √©tait vraisemblable. On peut certes arguer qu‚Äôil peut arriver que de brusques bourrasques s‚Äô√©l√®vent sur le lac de Galil√©e. Mais c‚Äôest d√©placer le probl√®me que d‚Äô√©valuer ainsi sa vraisemblance. En consid√©rant d‚Äôembl√©e cet √©pisode comme un mythe, il me semble qu‚Äôon le respecte davantage. Cet √©pisode devient alors une mise en sc√®ne de la puissance cosmique de cet √©tonnant pr√©dicateur. J√©sus vient d‚Äôenseigner √Ý la foule en paraboles. On ajoute qu‚Äôil explique tout en priv√© √Ý ses disciples. C‚Äôest cet enseignement particulier que J√©sus compl√®te maintenant, mais ailleurs, dans un nouveau lieu, au milieu du lac, quand les disciples interrompent subrepticement son sommeil. L‚Äô√©pisode de la temp√™te apais√©e compl√®te le discours de J√©sus pendant la journ√©e. Il en repr√©sente comme la face cach√©e, nocturne. La parole n‚Äôest pas une th√©orie¬Ý: elle reste inefficace √Ý moins d‚Äô√™tre accompagn√©e d‚Äôun agir √Ý r√©aliser gr√¢ce √Ý la force que conf√®re la foi en Dieu.
O√π retrouve-t-on dans la Bible du vent et des eaux en train de submerger des vivants¬Ý? Il y a d‚Äôabord le vent de Dieu qui planait au-dessus de la face des eaux lors du tohu-bohu primordial (Gen√®se 1,2). Le r√©cit du d√©luge en Gen√®se 6-8 est un retour √Ý un chaos dont triomphera finalement l‚Äôarche construite par No√©. D‚Äôautres passages interpr√®tent les eaux comme une menace ultime dont seul Dieu permet de triompher. ¬´¬ÝDieu, sauve-moi¬Ý: / l‚Äôeau m‚Äôarrive √Ý la gorge. / Je m‚Äôenlise dans un bourbier sans fond, / et rien pour me retenir. / Je coule dans l‚Äôeau profonde, / et le courant m‚Äôemporte¬Ý¬ª (Psaumes 69,2-3). ¬´¬ÝC‚Äôest toi qui ma√Ætrises l‚Äôorgueil de la Mer¬Ý; quand ses vagues se soul√®vent, c‚Äôest toi qui les apaises¬Ý¬ª (Psaumes 89,10). Dans la Bible, la mer est l‚Äôhabitat privil√©gi√© des forces mauvaises, note Marc Girard[5]. Quand les Isra√©lites, poursuivis par les √âgyptiens, √©taient sur le point de sombrer dans les eaux de la mer des Roseaux, ¬´¬ÝMo√Øse √©tendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d‚Äôest puissant et il mit la mer √Ý sec. Les eaux se fendirent¬Ý¬ª (Exode 14,21). Les fils d‚ÄôIsra√´l travers√®rent √Ý pied sec et furent sauv√©s. Le haut fait qu‚Äôaccomplit ici J√©sus r√©p√®te en fait celui attribu√© jadis √Ý Mo√Øse. Les Isra√©lites ont fait confiance √Ý Mo√Øse qui a fait confiance au Seigneur. Ce que r√©alise J√©sus sur la mer de Galil√©e le mue en un nouveau Mo√Øse qui, gr√¢ce au Seigneur, triomphe √Ý son tour du vent et des eaux de la mer de Galil√©e. Ce que J√©sus reproche aux disciples, c‚Äôest leur manque de foi en lui, qui est celui auquel le vent et la mer ob√©issent. J√©sus se r√©clame encore ici de Mo√Øse et de tous ceux qui √Ý sa suite vainquent les eaux tumultueuses de la souffrance et de la mort en faisant appel √Ý la force qui vient du Seigneur Dieu. Encore ici une cr√©ation litt√©raire qui plonge dans le lointain de la tradition juive, qui recentre l‚Äôattention autour du personnage de J√©sus, et qui rappelle imm√©diatement aux auditeurs de l‚Äô√âvangile les ultimes enjeux de son message.
Réflexion finale
Les r√©cits qui viennent d‚Äô√™tre pr√©sent√©s sont des √©pisodes qui font partie de l‚Äôhistoire de J√©sus ou de K·πõ·π£·πáa. Ils donnent √Ý premi√®re vue l‚Äôimpression de s‚Äôins√©rer dans une s√©rie pr√©cise d‚Äô√©v√©nements. De tels r√©cits ne s‚Äôappellent pas eux-m√™mes des mythes et cela importe peu. Le mot ¬´¬Ýmythe¬Ý¬ª est une appellation conventionnelle utilis√©e par les anthropologues pour tenter de comprendre des √©pisodes que la tradition inscrit dans un certain pr√©sent, mais en prenant soin de bien marquer l‚Äô√©cart qui les s√©pare de la vie ordinaire. Ces r√©cits sont des constructions qui ont pour fonction d‚Äôins√©rer le pr√©sent √Ý l‚Äôint√©rieur du pass√© d‚Äôun certain groupe social, de montrer la coh√©rence de la tradition, de montrer l‚Äôimportance d‚Äôinvoquer le pass√© pour donner du sens au pr√©sent, pour justifier ou l√©gitimer une nouvelle interpr√©tation d‚Äôun pr√©sent √Ý premi√®re vue en d√©calage avec la tradition.
Une fa√ßon moderne de d√©tourner le mythe de sa fonction, et donc de le subvertir, est pr√©cis√©ment de l‚Äôhistoriciser, c‚Äôest-√Ý-dire de tenter d‚Äôy d√©nicher des bribes d‚Äô√©v√©nements cens√©s s‚Äô√™tre vraiment d√©roul√©s dans un pass√© que l‚Äôon pr√©tend contr√¥ler et que l‚Äôon juge vraisemblables avec les yeux d‚Äôaujourd‚Äôhui. Ces r√©cits sont des traditions orales, des histoires √Ý r√©p√©ter dans le pr√©sent, √©ventuellement √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôune liturgie, mais qui fonctionnent par allusions, par clins d‚Äô≈ìil √Ý des v√©rit√©s anciennes, bien connues, indiscutables. Elles utilisent le pass√© pour l‚Äôactualiser, pour faire accepter des transformations qui s‚Äôimposent. Le mythe peut √™tre un discours innovant, mais qui dissimule ses innovations sous des figures traditionnelles. Dire que ces r√©cits sont ¬´¬Ýconstruits¬Ý¬ª ne veut pas non plus dire que ce sont des textes savants, accessibles qu‚Äô√Ý une √©lite. Ces r√©cits, j‚Äôen suis convaincu, √©taient imm√©diatement compr√©hensibles des auditeurs ou lecteurs bien ins√©r√©s dans leur tradition. Seul un certain oubli, ou une d√©sappropriation de la tradition qui est la sienne, oblige √Ý ce qui peut √™tre per√ßu comme un laborieux travail d‚Äôex√©g√®se.
En prenant comme exemples des r√©cits aussi diff√©rents mais aussi c√©l√®bres que l‚Äô√©pisode hindou du soul√®vement du mont Govardhana et les r√©cits chr√©tiens de la transfiguration et la mer apais√©e, je ne voudrais nullement laisser entendre que ces r√©cits s‚Äô√©quivalent. Le conclure serait n‚Äôavoir rien compris √Ý cette pr√©sentation. Le mythe n‚Äôexiste en tant que mythe que parce qu‚Äôil parle une langue bien sp√©cifique, reconnaissable, et qu‚Äôil v√©hicule un message irrempla√ßable.
Tant du c√¥t√© hindou que chr√©tien, il s‚Äôagit l√Ý de messages religieux. Et on pourrait √™tre port√© √Ý s‚Äôimaginer que le mythe n‚Äôappartient qu‚Äô√Ý des traditions un peu vieillottes. J‚Äôai d√©j√Ý √©voqu√© ailleurs[6] un autre r√©cit qui ressemble √Ý certains √©gards au r√©cit de la transfiguration ou √Ý la vision du dieu supr√™me qu‚Äôaccordera K·πõ·π£·πáa √Ý Arjuna dans la BhG, un r√©cit qui fonctionne exactement comme un mythe mais dont la port√©e se veut spirituelle. Il t√©moigne du fait que notre monde contemporain continue de s‚Äôappuyer sur des r√©cits. Cette histoire figure dans un livre de Shirley MacLaine intitul√© Danser dans la lumi√®re (1986). La c√©l√®bre actrice vient de rompre avec Vassy. Elle se cherche elle-m√™me et d√©cide de se rendre √Ý Santa Fe (Nouveau Mexique) pour travailler avec une certaine Cris Griscom. Cette sp√©cialiste d‚Äôacupuncture et de th√©rapie psychique utilise les aiguilles pour d√©bloquer les connexions nerveuses et capter les images enregistr√©es dans la m√©moire cellulaire du corps physique. Ces images, dit Cris √Ý Shirley MacLaine, viennent de sa propre exp√©rience pass√©e et peuvent l‚Äôaider √Ý r√©soudre des conflits de sa vie pr√©sente. Lors de la deuxi√®me s√©ance de th√©rapie, Shirley parvint √Ý l‚Äôextraordinaire vision qui polarisera d√©sormais toute son existence. ¬´¬ÝJe respirai profond√©ment au centre de moi-m√™me. Une image, diffuse tout d‚Äôabord, envahit mon esprit. Elle devint tr√®s claire, absolument stup√©fiante. Je voyais une forme de tr√®s grande taille tr√®s s√ªre d‚Äôelle, un √™tre humain presque androgyne. Un v√™tement gracieux, pliss√©, flottait autour de sa haute stature, ses bras reposaient tranquillement le long de son corps, que prolongeaient des doigts interminables. L‚Äô√©nergie de la forme me semblait plus masculine que f√©minine¬Ý: la peau color√©e, les cheveux auburn flottant jusqu‚Äôaux √©paules, les pommettes hautes et un nez long et fin. Ses yeux √©taient d‚Äôun bleu incroyablement profond, et le regard exprimait une infinie douceur derri√®re sa fermet√©. Il ouvrit les bras en signe de bienvenue. Un sentiment oriental, plut√¥t qu‚Äôoccidental m‚Äôenvahit, je le sentais extr√™mement protecteur, patient, mais sans aucun doute capable de grands courroux. L‚Äôallure simple, puissante aussi. On sentait bien qu‚Äôil savait tout ce qu‚Äôil y avait √Ý savoir. Ce que je voyais, et surtout ce que je ressentais me stup√©fiait au sens fort du terme¬Ý¬ª (p. 295).
Cette apparition n‚Äôa rien de commun avec par exemple la forme souveraine du Seigneur K·πõ·π£·πáa qui apparut √Ý Arjuna au chapitre XI de la BhG. Rien de comparable non plus avec ce Dieu envelopp√© de feu qu‚Äôaper√ßut Mo√Øse sur le mont Horeb et qui se proposait de faire alliance avec Isra√´l (Exode 3). Ce n‚Äôest pas non plus ce ¬´¬ÝFils bien-aim√©¬Ý¬ª qui appara√Æt √Ý Pierre, Jacques et Jean sur une montagne et que ceux-ci sont invit√©s √Ý ¬´¬Ý√©couter¬Ý¬ª (Marc 9,2-10). L‚Äô√™tre qu‚Äôaper√ßut Shirley sourit imm√©diatement et l‚Äôembrassa¬Ý; puis il se pr√©senta lui-m√™me comme son ¬´¬ÝMoi Sup√©rieur Illimit√©¬Ý¬ª. ¬´¬ÝOui, j‚Äôai toujours √©t√© l√Ý. Je suis √Ý tes c√¥t√©s depuis le d√©but des temps. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis toi. Je suis ton √¢me illimit√©e, ton Moi illimit√© qui te guide et te livre les enseignements, incarnation apr√®s incarnation¬Ý¬ª (ibid., p. 296).
Ce r√©cit est fort diff√©rent des mythes dont il vient d‚Äô√™tre question, et tout d‚Äôabord parce qu‚Äô√Ý premi√®re vue il n‚Äôest pas transmis √Ý l‚Äôint√©rieur d‚Äôune communaut√© explicite de croyants. Pourtant, si l‚Äôon y regarde de plus pr√®s, il s‚Äôagit toujours d‚Äôun r√©cit exemplaire dans lequel se reconna√Æt cette fois un cercle de lecteurs qui acceptent les valeurs spirituelles que v√©hicule ce r√©cit, un r√©cit que l‚Äôon peut juger aussi √©ph√©m√®re que la communaut√© informelle des lecteurs qui l‚Äôappr√©cient et se le transmettent. Ce mythe ‚Äî car il s‚Äôagit √Ý mon avis d‚Äôun v√©ritable mythe ‚Äî ne parle plus d‚Äôun Dieu tout autre ou d‚Äôun grand principe cosmique auquel l‚Äôhumain doit se confronter comme √Ý une instance diff√©rente de lui-m√™me. Il met en sc√®ne un Moi qui prend toute la place et est capable de tout, une conscience qui se suffit √Ý elle-m√™me au point de constituer elle-m√™me la norme ultime, et sans aucune limite. Ce qui caract√©rise la spiritualit√© dite du ¬´¬ÝNouvel √Çge¬Ý¬ª est d‚Äô√™tre en rupture totale avec toute autorit√© ext√©rieure, et en particulier avec les autorit√©s religieuses et les groupes qui en d√©pendent. Elle r√©pond √Ý un nouveau contexte social complexe qui affranchit l‚Äôindividu du besoin de recourir √Ý des instances auxquelles il devrait se soumettre, √Ý un monde in√©dit o√π se multiplient les communaut√©s implicites, virtuelles, qui se font et se d√©font au gr√© des modes. Ce nouvel individu se nourrit de tout ce qui lui permet de s‚Äôaccomplir, y compris les grands textes religieux, mais comme il l‚Äôentend, en empruntant aux bibles et aux auteurs faisant jadis autorit√© ce qui fait son affaire, en r√©interpr√©tant tout √Ý sa fa√ßon, et sans devoir s‚Äôen justifier. Le Moi illimit√© de Shirley MacLaine, comme celui que chaque individu est cens√© abriter, est une r√©f√©rence ultime et renferme √Ý chaque fois tout le cosmos. Il trace les limites d‚Äôun espace int√©rieur o√π tout converge vers le moi et qui est en fait le seul v√©ritable domaine du nouveau spirituel. Alors que les mythes √©tudi√©s jusqu‚Äôici √©taient tir√©s des grandes traditions religieuses de l‚Äôhumanit√©, s‚Äôadressaient √Ý des communaut√©s ayant pignon sur rue, et pr√©sentaient des dieux grandioses devant lesquels l‚Äôindividu devait s‚Äôincliner, l‚Äôexp√©rience de Shirley MacLaine montre que le mythe peut encore √™tre un discours parfaitement actuel, toujours aussi vivant chez les humains quels qu‚Äôils soient, et toujours aussi capable de donner du sens √Ý des communaut√©s insaisissables et fugaces de spirituels. Il s‚Äôagit alors d‚Äôun mythe refa√ßonn√© autour d‚Äôun Moi autorit√© supr√™me et qui n‚Äôa plus rien √Ý voir avec les grands discours religieux de l‚Äôhumanit√©.
[1] Je remercie Alain Bouchard, spécialiste des nouveaux mouvements religieux, Guy Bonneau, spécialiste de l’exégèse du Nouveau Testament, également les deux indianistes Catherine Clémentin-Ojha et Denis Matringe d’avoir relu ce texte et de m’avoir fait diverses suggestions.
[2] Claude Lévi-Strauss, L’anthropologie structurale, Paris, Plon, 1974 (1958), p. 230.
[3] Ibid., p. 242.
[4] Pour davantage d‚Äôinformations sur ce r√©cit, on pourra se reporter √Ý Andr√© Couture, ¬´¬ÝLa place d‚ÄôIndra dans l‚Äô√©pisode du soul√®vement du mont Govardhana selon le Hariva·πÉ≈õa¬Ý: les pr√©suppos√©s d‚Äôune interpr√©tation¬Ý¬ª, Cahiers des √©tudes anciennes 54, 2017, p. 127-156. J‚Äôai traduit cet √©pisode dans Andr√© Couture, L‚Äôenfance de Krishna, Paris, Cerf¬Ý; Qu√©bec, Presses de l‚ÄôUniversit√© Laval, 1991, p. 235-262.
[5] Marc Girard, Les symboles dans la Bible. Essai de th√©ologie biblique enracin√©e dans l‚Äôexp√©rience humaine universelle, Montr√©al, √âditions Bellarmin¬Ý; Paris, Cerf, 1991, p. 255-267, part., p. 259.
[6] Voir La réincarnation, Paris, Cerf, 2000, p. 60-62.